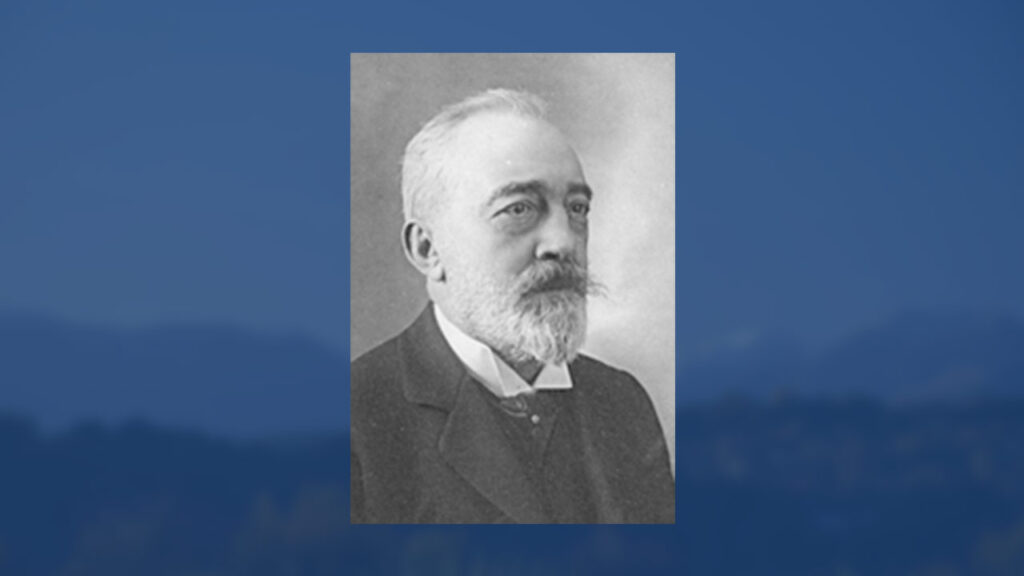Poursuivant ses conversations académiques, l’Académie de Béarn avait invité, vendredi 12 novembre Patrick Voisin à nous révéler « Les mille et un mots des mets et des vins », comme le résume si bien le titre de son dernier ouvrage.
Agrégé de grammaire, professeur de littérature française et de lettres latines en khâgne et en hypokhâgne au lycée Louis Barthou à Pau pendant plus de vingt ans, Patrick Voisin propose dans son livre écrit avec Françoise Argod-Dutard, bien des surprises et des découvertes. Ce livre d’érudits offre des informations sérieuses, mais accessibles et plaisantes, sur l’histoire de l’alimentation. Les mots, judicieusement choisis, lient la grande histoire et les petits secrets de cuisiniers et de dégustateurs connus. Ces mots sont expliqués dans leur histoire à partir de leur étymologie donnant à ce dictionnaire une véritable valeur linguistique.
Pour celles et ceux qui n’ont pu assister et prendre part à cette conversation académique, nous reproduisons ci-dessous la présentation prononcée par le président de l’Académie Marc Bélit et le texte de l’intervention Patrick Voisin.
Marc Bélit : « À lire cet ouvrage imposant, on se régale »
« Sur un sujet comme celui des vins et des mets, on attendrait tout sauf un dictionnaire. Il faut donc être un universitaire pour nous proposer de nous mettre des mots en bouche en lieu et place des mets, quoique… Les grands cuisiniers nous ont laissé des livres de cuisine, d’Escoffier à Ducasse en passant par Curnonski prince des gastronomes, écrivain et ami de Paul Jean Toulet, et la cuisine des familles beaucoup de livres de recettes. Il y a tant et tant de littérature, de recettes et de conseils qu’il est vrai que nous ne sommes pas privés de références ; mais quelle est donc l’utilité d’un dictionnaire de notions se demande-t-on ?
Il faut donc le demander à ce subtil agrégé de grammaire, spécialiste de littérature antique, de la Grèce et de Rome qu’est Patrick Voisin qui a partagé sa partition avec Françoise Argos-Dutard professeur à Bordeaux Montaigne et experte elle en matière de vins et même de cognac.
En fait, à lire cet ouvrage imposant, on se régale. L’avantage est de pouvoir segmenter sa lecture et de pratiquer « à sauts et gambades » dans les rubriques des 500 pages qui proposent des entrées notionnelles sur fond d’histoire culturelle qui tire parfois du côté de l’ethnologie. On remarquera aussi qu’il n’y a pas que nos professeurs mais bien d’autres mains de spécialistes qui ont pris part à ce recueil savant, ce qui pique la curiosité.
Et tout d’abord on y parle des manières de table, des produits, des cultures avant de nous parler de la façon de les cuisiner qui relève des savoirs faire et de l’art culinaire proprement dit.
On ne s’étonnera pas de constater que les grandes périodes de civilisation s’accompagnent de grande cuisine et qu’au contraire les siècles difficiles aient été plus frugaux. Que Soubise ou Parmentier ont eu leur part dans la découverte de recettes fameuses, mais que Rossini ou Chateaubriand eussent assez de goût pour avoir laissé leur nom à des recettes de viandes n’est plus à démontrer. Quant à Antonin Carême son nom ne l’a pas voué à la tristesse des faces qui font le jeûne comme on aurait pu le croire.
Bref, s’il ne met pas forcément toujours l’eau à la bouche ce livre est rempli d’anecdotes et de secrets parmi des développements savants. Il sait nous intéresser à l’histoire du chou : le chou-fleur, celui de Bruxelles ou le chou à la crème. Il nous rappelle que le café se disait d’abord « cahoa » ou « caüe » du turc « Kahvé » et de l’arabe « qahwa » qui prit définitivement le nom de « caoua » dans les armées d’Afrique et qu’il est originaire d’Éthiopie, il nous enseigne que la figue qui est le fruit domestiqué le plus ancien au monde sans doute, en tout cas au Moyen orient, puisqu’on les date de 9 400 ans, doit selon un proverbe, avoir un habit de pauvre (pellicule grisâtre et fripée), un œil d’ivrogne (mouillée avec une gouttelette perlant à l’ostiole) et un cou de dévote (retombante par rapport au pédoncule) pour être délicieuse. Et c’est ainsi que le livre qui nous conte l’histoire des mots qui désigne les mets est tout autant un livre de recettes qu’un livre de littérature. Ne dit-on pas que l’eau vient à la bouche à la simple évocation des mets ?
Naturellement je cite ces extraits pour vous donner à entendre son auteur et non pour dire à sa place ce qu’il dira bien mieux que moi, puisqu’il l’a écrit. Je lui laisse la parole ».
Patrick Voisin « Comme notre cuisine nationale émerge et va contribuer à l’idée de nation française »
« L’ouvrage pour lequel l’Académie du Béarn me fait l’honneur de m’inviter, Les Mille et Un Mots des Mets et des Vins (Féret, 2019) – codirigé avec Françoise Argod-Dutard et primé aux Gourmand World Cookbook Awards 2020 (1er prix en France et 2èmeprix mondial) dans la catégorie Food Writing (« Mots Culinaires ») –, contient presque mille et une pistes de travail et de réflexion sur l’alimentation, la cuisine et la gastronomie, dans la chaîne qui conduit le produit du terroir vers sa sublimation entre les mains de grands chefs. Construit en deux parties, l’ouvrage se présente tout d’abord comme une histoire synthétique de la cuisine à travers les civilisations et les siècles, jusqu’à nos jours, puis comme un dictionnaire des mots qui représentent dans le langage l’univers passionnant des mets et des vins.
La question que je souhaite ici problématiser – au-delà d’une simple description d’ordre historique de l’évolution de la cuisine française entre Moyen Âge et XXIe siècle – est celle d’une révolution qui s’est produite entre le règne de Louis XIV et la Révolution Française de 1789 : une cuisine nationale émerge, s’articulant avec celle des terroirs et s’autonomisant par rapport à la cuisine des cours européennes, parallèlement à d’autres évolutions dans les sciences et dans les mœurs, même si le cadre est toujours celui de l’Ancien Régime. Une cuisine française se constitue et va contribuer elle-même à constituer l’idée de nation française.
Pour comprendre la dialectique du territoire et des terroirs sur laquelle la cuisine française va s’élaborer, il convient tout d’abord de définir précisément les mots « territoire » et « terroir », devant la confusion avec laquelle on emploie aujourd’hui le mot « territoires » au pluriel pour désigner des quartiers ou des régions, alors que ce mot ne devrait désigner que le territoire national ! Ayant la même origine latine (terra « la terre »), ils ont comme point de départ territorium (latin classique) pour « territoire » et terratorium (latin populaire avec altération gallo-romaine) pour « terroir », et ils apparaissent plus ou moins en même temps dans la langue, au XIIIe siècle.
Mais, si leur sens est le même au départ, celui d’étendue de la surface terrestre sur laquelle vit une collectivité humaine constituée – ce qui suppose au moins des frontières et une autorité politique –, seul le mot « territoire » a gardé ensuite cette valeur extensive, alors que le mot « terroir » a développé une valeur intensive en désignant l’essence qui caractérise une partie du territoire en raison d’une certaine homogénéité physique originelle ou du développement de techniques culturales particulières se constituant en traditions. On parlera ainsi d’un vin de terroir, et non d’un vin de territoire, de même qu’il y a une sûreté du territoire, et non du terroir ! Les deux mots ne sont plus interchangeables.
Dès lors, étudier la relation entre « territoire » et « terroir » en matière d’alimentation, de cuisine et de gastronomie revient à approfondir comment elle s’articule : dans l’opposition ou dans l’échange, dans la fusion ou dans la différence acceptée ?
Au XVIIe siècle – et non à la Renaissance, qui n’a modifié en rien les pratiques alimentaires et culinaires, contrairement aux arts et aux lettres par exemple –, une rupture se produit dans l’alimentation aristocratique: une authentique cuisine française va s’individualiser et se séparer de celle des autres cours européennes. Jusqu’à la fin du XVIe siècle, existaient soit une cuisine européenne commune et semblable dans toutes les cours – cuisine dite aulique –, soit une cuisine de terroirs – ou des cuisines de terroir – faite de spécialités que l’on appellera régionales, car, depuis toujours, « nos régions ont du talent ». Des textes comme la Relation du voyage de la Royne de Pologne par Jean Le Laboureur (1648) nous permettent de connaître cette cuisine européenne, caractérisée par les épices, l’huile, les cuissons longues, le bouilli, le gibier… Or, à partir du XVIIe siècle, ce sont trois cuisines qui vont exister en parallèle : la cuisine aulique se maintient dans les cours européennes, la cuisine des terroirs n’a pas de raison de disparaître, mais apparaît une cuisine nouvelle – qui peut faire figure de « nouvelle cuisine » –, la cuisine française qui permet au territoire d’acquérir une nouvelle dimension culturelle, une de ces spécificités qui constituent l’originalité et l’identité de la France… jusqu’à la reconnaissance par l’UNESCO, en 2010, du « repas gastronomique des Français » qui entre au Patrimoine universel de l’humanité.
Cette cuisine française, appelée à sortir ensuite des frontières du territoire qu’est le royaume pour voyager à travers l’Europe et le monde entier, accorde une préférence aux herbes aromatiques (bouquet garni) plutôt qu’aux épices, pour une cuisine pleine de fraîcheur mettant fin à l’aigre-doux et au sucré-salé ; elle introduit le beurre dont les conséquences majeures sont dans l’apparition des sauces qui caractérisent la cuisine française (beurre blanc, roux, béchamel…) ; elle invente des pré-cuisines : déglaçages, jus, émulsions, liaisons, fonds de sauce ; les cuissons deviennent courtes, étuvées ou rôties ; la viande de boucherie remplace le gibier; les légumes verts (petits pois) chassent les légumes racines; les fruits accompagnent la fin du repas au lieu des desserts lourds et sucrés. Ce nouveau goût qui se forme à la cour de France devient la vitrine de la nation française, comme le montre le Séjour à Paris, instruction fidèle pour les voyageurs de condition de Joachim-Christoph Nemeitz (1727). Culturellement, c’est une révolution : les régions vont alimenter la cuisine française, au lieu des produits de l’expansion coloniale, et les autres cuisines européennes vont vite apparaître comme des cuisines contre nature.
Trois conséquences en découlent. Tout d’abord, la supériorité de l’ailleurs oriental liée aux épices s’efface devant la prise de conscience d’une supériorité européenne incarnée en cuisine par la France et Paris, dans la rivalité avec l’Italie de la Renaissance et la Rome papale ; la cuisine française va ainsi augmenter le prestige politique, diplomatique et culturel du royaume. Ensuite, l’écart entre les classes sociales va s’atténuer au regard de la cuisine par une sorte de nationalisation de celle-ci à travers une compétition – ou, mieux, une émulation – entre aristocratie et bourgeoisie : la cuisine bourgeoise va dès lors grignoter du terrain sur la cuisine aristocratique. Enfin, la cuisine française ne va pas se développer contre les régions, mais dans l’addition des produits que fournissent les terroirs ; ce que ces derniers ont de meilleur et qui fait l’originalité des cuisines régionales va s’unir et même se fondre dans une cuisine nationale élaborée d’abord à Paris puis bientôt partout sur le territoire, formant une sorte d’« équipe de France » : un agneau du Béarn cuisiné au beurre des Charentes et relevé d’un citron de Menton, c’est la marque d’une cuisine de creuset… et Le Creuset est d’ailleurs la référence française dans la fabrication des cocottes en fonte depuis 1925 !
Il faut ajouter que la cuisine française bénéficia de toutes sortes de progrès contemporains, progrès social sous la Régence et le règne de Louis XV, grâce au retour de la paix et à la sociabilité, mais, surtout, progrès techniques : les degrés Fahrenheit et Celsius, la machine à pétrir le pain, le digesteur d’aliments de Denis Papin, la conserve par appertisation, la fermentation du vin de Champagne, l’extraction de sucs et d’essences… Les cafés se multiplient dans Paris et le bouillon restaurant – dorénavant nommé « restaurant » – sort la cuisine française des maisons aristocratiques pour la rendre accessible au moins à la bourgeoisie, car les grands cuisiniers qui travaillaient pour les nobles s’établissent avec pignon sur rue. La cuisine devient science et prend sa place dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, cuisine inventive et digeste. Bref, au bout d’un siècle de travail, le mot « gastronomie », apparu en 1623, trouve sa concrétisation, opposant la France aux autres pays européens en matière de cuisine. S’il y a un emblème de cette cuisine nationale c’est bien la pomme de terre : originaire du Pérou, ayant une mauvaise réputation pendant longtemps, nourriture pour les animaux, prétendue toxique, elle devient l’accompagnement d’une poularde de Bresse au Café Procope, puis fut associée à la truffe et au caviar, trouvant ainsi ses lettres de noblesse !
Un facteur fut également fondamental dans l’élaboration d’une cuisine du territoire à côté de celle des terroirs : la constitution d’une littérature culinaire permit de codifier, de définir et de légiférer, pour la reconnaissance d’une norme culinaire française, avec l’effet parallèle suivant, à savoir que l’alimentation et la cuisine, choses triviales jusqu’alors, transcendées par cette littérature culinaire, deviennent un sujet de conversation qui ancre un peu plus la spécificité culturelle. Pendant tout le XVIe siècle, il n’y a de références culinaires – comme l’illustre bien Rabelais – que Le Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent ou Le Ménagier de Paris (œuvres du XIVe siècle). Il faut attendre un siècle pour que la révolution de la cuisine française s’écrive en 1651 avec Le Cuisinier français de François Pierre sieur de La Varenne (qui a été cuisinier d’Henri IV), réédité 41 fois jusqu’en 1700, puis traduit dans toute l’Europe. Dès lors, presque tous les ouvrages culinaires vont comporter le mot « français » dans leur titre: Le Pastissier François (1653), Le Confiturier François (1660), Le Cannameliste François (1751), Le Parfait Cuisinier Français (1799) ; c’est le manifeste d’une revendication d’identité nationale à travers un modèle français, et ces ouvrages sont destinés tant aux professionnels de cuisine qu’aux amateurs ; on observe le même processus pour ce qui est de l’approvisionnement en amont et du service à table en aval.
Trois facteurs découlent de cette construction de la cuisine française par une théorie écrite dans des livres. Tout d’abord, la cuisine française va étouffer toute création à l’identique de cuisines nationales à l’étranger ; Samuel Pepys explique qu’à Londres un cuisinier français est précieux ; Frédéric II de Prusse a des cuisiniers français et la table se francise en Espagne sous Philippe V ; quant à Vincent La Chapelle et Clouet, ils firent des carrières européennes au service des Grands de l’époque. Enfin, les livres de cuisine étrangers mettent à l’honneur la cuisine française : par exemple, L’École des ragousts devient en Italie Il cuoco francese. De la sorte, c’est un idéal sociétal français qui accompagne la cuisine française partout en Europe, constituant la nation française de façon pacifique. Ensuite, la littérature culinaire, entre les mains de la population, par le biais des ouvrages de vulgarisation (dictionnaires portatifs, almanachs…) peu coûteux pour le petit peuple, va rapprocher les couches sociales : Massialot fait coexister deux publics dans son best-seller de l’époque Le Cuisinier royal et bourgeois (1691), Menon est l’auteur à la fois de La Cuisinière bourgeoise (1746) et des Soupers de la Cour (1755), et Madame Mérigot rassemble toute la nation autour de la cuisine, en 1795, avec son ouvrage La Cuisinière républicaine. Grâce à la littérature culinaire qui se révèle être l’organe de communication et d’échange essentiel, on assiste tout autant à une ouverture sociale de la cuisine aristocratique vers la bourgeoisie qu’à un embourgeoisement de la première par la deuxième, car les mêmes recettes sont adaptées aux moyens financiers des uns et des autres. Enfin, la littérature culinaire va souder la nation en rapprochant les villes (relais du territoire dans les provinces) et les campagnes exprimant la richesse des terroirs, via la bourgeoisie provinciale et l’économie rurale, comme le montre Le Ménage des champs et de la ville ou Nouveau Cuisinier français de Liger (1714). Le symbole en est encore la pomme de terre célébrée par la littérature culinaire, pièce incontournable de la cuisine française – qu’elle soit consommée à la ville ou à la campagne, à la cour, dans les maisons bourgeoises ou par le petit peuple –, grâce à Antoine Parmentier et à la famille royale de Louis XVI.
Il y avait un risque, celui que la cuisine française ne soit qu’une somme de cuisines régionales liées à la diversité et à la richesse des terroirs (le cassoulet du Languedoc, la choucroute d’Alsace, le far breton…) avec une spécificité coupée des terroirs, la cuisine parisienne ; or, cela n’a pas eu lieu et il n’existe au XVIIe siècle qu’un ouvrage consacré aux pratiques culinaires régionales : Le Cuisinier méthodique (1660). Certes les produits et les tours de main viennent des terroirs, mais ils se fondent dans des recettes françaises car la cuisine se crée et s’écrit à Paris, unifiant les terroirs et faisant que des produits régionaux deviennent des produits français, « origine France » dirait-on aujourd’hui. En retour, la cuisine française dit la diversité et la richesse des terroirs, comme dans « le Ventre de Paris » zolien des Halles, remplacées de nos jours par le Marché de Rungis, ou sur n’importe quel marché parisien de quartier : la volaille de Bresse y côtoie le poisson de Dieppe ou de Boulogne-sur-mer et la viande de l’Aubrac, sans oublier le fromage AOP Ossau-Iraty.
La suite, que je n’aborderai pas ici faute de temps, s’écrit au XIXe siècle : les élites nouvelles, c’est-à-dire la bourgeoisie, vont mettre en avant – dans une sorte de rééquilibrage – la cuisine des terroirs ou les cuisines de terroir, de même que se développe la cuisine populaire des bouillons ; mais, jamais la cuisine nationale n’en sera pour autant contestée, ni affaiblie ; elle sera au contraire consolidée à l’échelle du monde ; elle a accédé au rang des beaux-arts supérieurs aux arts mécaniques, faisant des cuisiniers des artistes, elle va partir à la conquête du monde sur les transatlantiques et dans les palaces. La vaisselle, la verrerie, les nappes, le mobilier – bref les arts de la table – ajoutent à la performance artistique que représente un repas gastronomique. Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, devient « le roi des chefs et le chef des rois », sous Napoléon 1er, et la gastronomie va suivre sa progression ascendante avec Brillat-Savarin, Auguste Escoffier et Curnonsky, parmi tant d’autres, pérennisant la table comme le lieu d’une identité, car ce qui n’est au départ qu’une question d’alimentation se transforme en question de culture sous le signe de l’excellence.
C’est par la cuisine de terroir – et plus particulièrement de notre terroir – que je termineraicet exposé sur la relation qu’entretiennent la cuisine française et les cuisines régionales depuis le XVIIe siècle ; elle existe bel et bien en Béarn. Les vins locaux l’accompagnent : le Pacherenc du Vic-Bilh (mot venant des pachets en rèncs ou échalas permettant le passerillage), le Madiran qui profita des conseils donnés par les cisterciens de Vougeot aux bénédictins de l’abbaye de Madiran au Xe siècle, et le Jurançon d’Henri IV, « bi dou rey, rey dou bis », sans oublier, non loin de là, l’Armagnac, le Buzet, le Gaillac et le Tursan dont le cépage lui est propre : le baroque. Les produits locaux entrent dans une cuisine spécifique, telle la truite fario du gave ; le boudin béarnais est différent de celui d’autres régions et l’andouille de Béarn ne ressemble pas à celle de Bretagne ou de Normandie. Le Pays Basque voisin apporte le cabillaud et le jambon affiné au sel de Salies-de-Béarn ; le chocolat et la sauce espagnole sont passés par Bayonne dans le sillage du mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche à Saint-Jean-de-Luz. La cuisine du cochon et celle du canard ne sont certes pas l’apanage du seul Béarn, mais, même si l’Alsace s’approprie la transmission du foie gras venu des Égyptiens, des Hébreux et des Romains, il n’empêche que le magret, inventé par André Daguin en 1959 dans son restaurant d’Auch, l’Hôtel de France, et la garbure, dont la première mention date de 1740 dans Le Cuisinier gascon du prince de Dombes, Louis-Auguste de Bourbon, petit-fils de Louis XV, sont bien liés à notre région. La palombe chassée depuis les palombières pour un salmigondin (Rabelais) ou un salmigondis, puis un simple salmis, est une des spécialités de la chasse régionale, sans évoquer le braconnage, la cuisine et le rituel de dégustation de l’ortolan ! Enfin, de façon non exhaustive, la croustade du Gers et la tourtière des Landes, avec une simple différence de nom renvoyant à l’occitan ou au gallo-romain, qu’elles soient aux pommes ou aux pruneaux et flambées à l’Armagnac, constituent le dessert béarnais à moins que ne soit servi un gâteau à la broche de Bigorre. En revanche, le navarin d’agneau (qui tire son nom du légume qui accompagne la viande, le navet) n’a rien à voir avec la Navarre, tout comme la sauce béarnaise doit son nom au fait qu’elle a été inventée en 1837 par Collinet au restaurant du Pavillon Henri IV, mais à Saint-Germain-en-Laye ! Enfin, la poule au pot, présentée comme une cuisine nationale à partir de la belle histoire racontée par Hardouin de Péréfixe dans son ouvrage Histoire du roi Henri le Grand (1661), cinquante ans après la mort d’Henri IV, pour valoriser son terroir d’origine, au prétexte que le bon roi Henri aurait confié ces mots au duc de Savoie Charles- Emmanuel 1er : « Si Dieu me donne encore la vie, je ferai qu’il n’y ait pas de laboureur en mon royaume qui n’ait moyen de mettre une poule dans son pot », cette poule au pot relève assurément plus du folklore que de la science historique et politique ! C’est bien une cuisine de terroir, donc une cuisine de France, puisque le Béarn a été annexé à la France, mais pas une cuisine française ou nationale.
Pour conclure, si l’on dépasse l’idée qu’il y a eu une évolution, voire une révolution de la cuisine en France avant la Révolution de 1789, avec une nation qui se nourrit de ses régions, la cuisine offre un apologue qui se prête à une morale plus générale sur la relation que doivent entretenir le territoire et les terroirs, à la manière de la fable de La Fontaine intitulée « Les Membres et l’Estomac » remontant elle-même au fabuliste Ésope et à Ménénius Agrippa via l’historien romain Tite-Live. À l’heure où la souveraineté du territoire français se fond dans l’entité européenne et où la décentralisation des régions fragilise l’unité du territoire, il y a une leçon à méditer : la nation doit rester une et indivisible, caractérisée par son identité, ce qui n’exclut en rien qu’elle valorise ce que lui apportent ses terroirs.
Cuisine et politique ne sont d’ailleurs jamais éloignées l’une de l’autre avec le chroniqueur gastronomique Périco Légasse, dans les émissions successives qu’il a animées à la télévision (À la carte sur France 3, Toques et politique sur la chaîne parlementaire de l’Assemblée nationale, Manger c’est voter sur Public Sénat) ou dans ses récents ouvrages À table citoyens ! (2016) ou Du panier à l’assiette (2018). Avec Danièle Sallenave, il s’est livré en 2002 à un entretien croisé publié sous le titre Nos amours de la France – République, identités, régions, où ils cherchent un équilibre entre jacobinisme culinaire et cuisines locales. Mais je n’aborderai pas plus avant la fameuse « cuisine politique » qui nécessite de changer d’assiette !
Cuisine, territoire et terroirs – pour reprendre les mots du titre à l’envers – fournissent une piste de travail parmi d’autres à partir de l’ouvrage Les Mille et Un Mots des Mets et des Vins. La relation qu’entretiennent alimentation, cuisine et gastronomie avec l’hygiène et la médecine en serait une autre, très intéressante également, de même que l’élaboration lointaine du concept de « nouvelle cuisine » ou encore l’intérêt – qui n’est pas récent ! – porté aux légumes et aux fruits par des précurseurs d’une alimentation végétarienne ou végane, problématiques que j’ai déjà développées ou que je vais approfondir par ailleurs ».
Patrick Voisin « Entretien avec Patrick Voisin », Parvis Espace culturel, 31 janvier 2020 :